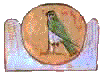 |
 |
|
LA R�SURRECTION DE L`OEUVRE ARCHITECTURALE D`IMHOTEP � SAQQARAH. Profesor Jean-Philippe Lauer. Miembro de Honor del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto.
|
|
A
Imhotep y a Jean-Philippe Lauer.
Dos
arquitectos, dos �pocas, una eternidad...
Selon
l'historien Man�thon, pr�tre �gytien du III�me si�cle avant notre
�re, "c'est [� la III�me dynastie,env.2720-2640] sous le r�gne
de Tosorthros [ou S�sorthos] que v�cut Imhout�s qui,en raison de sa m�dicale
est consid�r� comme Askl�pios; il fut l'inventeur de la construction
en pierre de taille et s'adonna �galement � l`art d'�crire".
Or depuis longtemps le nom de Tosorthros ou S�sorthos a �t�
identifi� par les �gyptologues � celui du roi Zoser ou Djoser, tandis
que celui d'Imouth�s l'�tait � Imhotep, son premier ministre,
architecte et m�decin. Ce dernier v�n�r� comme un sage � l'Ancien
et au Moyen Empire, puis au Nouvel Empire comme un savant, sup�rieur
des pr�tres-lecteurs el patron des scribes en raison de ses �crits
auxquels il est parfois fait allusion, para�t d�s l'�poque ramesside
au Papyrus royal de Turin avoir �t� consid�r� comme le fils du grand
dieu Ptah de Memphis. Cette origine divine lui est ensuite attribu�e de
fa�on constante aux �poques sa�te et perse, et peu apr�s il sera d�ifi�
pour sa science m�dicale. Selon certains textes ptol�ma�ques, un
temple, Askl�p�ion encore � d�couvrir, fut �difi� pour son culte
pr�s de Memphis aux approches du S�rap�um, par cons�quent �
Saqqarah, o� pr�cis�ment quelques statuettes de lui en bronze ont �t�
recueillies
N�anmoins, l'existence m�me d'Imhotep sous le r�gne de Djoser
pouvait para�tre encore plus ou moins l�gendaire avant la d�couverte
en 1.926, par l'arch�ologue anglais Cecil Firth, de son nom et de sa
titulature grav�s sur un socle de statue de l'Horus Neterikhet (c'est-�-dire
Djoser, nous allons le d�montrer); ce socle fut recueilli � quelques
dizaines de m�tres au Sud de la colonnade d'entr�e du vaste ensemble
monumental �difi� autour de son tombeau, la c�l�bre Pyramide � degr�s.
La d�couverte de ce socle corrobore, en effet, par le nom et la
titulature d'Imhotep qu'il comporte, l'identit� de l'Horus Neterikhet
et du roi S�sorthos de Man�thon, autrement dit le Zoser des listes hi�roglyuphiques
royales du Nouvel Empire. Cette identit� seulement �tablie jusque l�
par un document ptol�ma�que, la st�le de l'�le de S�hel, toute
proche d'Assouan, relatant la consultation d'Imhotep par Djoser �
propos d'une famine, et donnant le protocole complet de ce pharaon
avec ses deux noms Horus Neterikhet et Djoser dans un cartuche,
se trouvera en outre confirm�e par des graffiti de visiteurs du Nouvel
Empire relev�s sur les parois int�rieures des deux �difices du
complexe monumental de la Pyramide � degr�s, appel�s "la maison
du Sud" et "la maison du Nord". Ces scribes, qui semblent
ignorer le nom d'Horus Neterikhet, disent �tre venus visiter le temple
du roi Djoser "le justifi�".
Mais voyons le socle en question sur la premi�re diapositive: �
sa partie sup�rieure, en premier plan, trois oiseaux rekhytou figurent
en l�ger relif le peuple �gyptien devant la statue de l'Horus
Neterikhet, dont seuls conserv�s les pieds foulant les "neuf arcs",
c'est-�-dire les tribus �trang�res soumises. Sur sa partie frontale
le socle pr�sente en son centre le nom d'Horus du roi Djoser, "Neterikhet"
dans le serekh surmont� du faucon, et face � ce dernier, au lieu du
protocole habituel n-sw-bit comprenant le roseau de la Haute-�gypte et
l'abeille de la Basse-�gypte suivis du nom du roi, l'abeille se trouve
ici seule, suivie de deux signe sn, qu'il semble difficile de consid�rer
comme son nom de roi simplement de Basse-�gypte, ce dont on ne conna�t
pas d'autre exemple � cette �poque. Il semble ainsi plus probable
qu'il s'agirait l� au lieu du nom du roi du Nord d'une qualification
particuli�rement importante d'Imhotep par rapport � ce dernier.
Cette inscription centrale est bord�e � droite par un noeud
d'Isis et � gauche par un pilier Djed (symbole de r�surrection et de
stabilit�). A droite du noeud d'Isis, deus autres piliers Djed
encadrent un second noeud d'Isis.
Du c�t� gauche, avant le premier pilier Djed, la titulature
suivante est grav�e en relief: "le chancelier du roi de Basse-�gypte,
le premier apr�s le roi de Hautre-�gypte,l'administrateur de la maison
royale, le noble h�r�ditaire, le grand pr�te d'H�liopolis,
Imhotep". Son nom surmonte alors une derni�re ligne de titres plus
modestes: charpentier-constructeur, sculpteur-graveur et probablement
fabricant de vases de pierre (grande industrie de l'�poque) dont on
n'entrevoit que l'extr�mit� d'un signe.
La question s'est ainsi pos�e de savoir si ces derniers titres
concernaient �galement Imhotep, ou s'ils ne se seraient pas appliqu�s
plut�t � un autre personnage?. On si, comme le propose � juste titre
Battiscombe Gunn, l'inscription avait �t� bord�e � gauche par un
dernier noeud d'Isis, la
place aurait manqu� ajouter l� un autre nom. C'est pourquoi nous
avions sugg�r� qu'il pourrait s'agir des principaux corps de m�tier
travaillant � la r�alisation de la demeure d'�ternit� du roi sous la
direction d'Imhotep, qui les repr�sentait ainsi en personne. Ce point
de veu a �t� admis depuis par le Professeur D.Wildung dans sa savante
tr�se sur Imhotep et Amenhotep.
Quoi qu'il en soit, Imhotep eut ainsi l'insigne honneur de
pouvoir faire figurer son nom et toute sa titulature sur la premi�re
statue royale visible lorsqu'on avait p�n�tr� dans le complexe fun�raire,
o� elle aurait �t� plac�e sans doute dans le petit sanctuaire dispos�
imm�diatement au Sud du milieu de la colonnade d'entr�e.
Tout cela confirme donc parfaitement le dire de Man�thon, �
condition, toutefois, d'interpr�ter le terme d'"inventeur" de
la construction en pierre de taille, non de fa�on absolue, mais dans le
sens plus large de premier grand promoteur,car quelques exemples
d'emplois partiels appareill�es en assises r�gl�es sont connus
avant le r�gne de Djoser, mais sur de tr�s petites surfaces. Imhotep r�ussit,
malgr� toutes les difficult�s qu'il y avait n�cessairement � vaincre,
� transposer dans la pierre, avec un art consomm�, des formes propres
� d'autres mat�riaux,et plus particuli�rement � la brique crue, dont
l'architecture avait alors atteint un grand d�veloppement. C'est sans
doute avec la collaboration pr�cieuse des fabricants de vases de pierre
qu'il put r�aliser cette transposition. Ces derniers, pour se consacrer
principalement � la taille et � l'�pannelage des nouveaux �l�ments
architectonique en pierre, durent d�s lors rel�guer au second
plan leur industrie, dont l'apog�e avait �t� atteinte d�s avant le d�but
de la I�re dynastie, vers la fin du quatri�me mill�naire avant notre
�re. Le recul de cette industrie ne fera, en effet, � partir de la III�me
dynastie que s'accentuer au fur et � mesure du d�veloppement de
l'architecture de pierre, de la sculpture et de l'art du bas-relief.
Les projections vont vous montrerr les diff�rents vestiges de ce
si vaste complexe monumental de la yramide � degr�s, qui couvrent 15
hectares et furent exhum�s des sables en majeure partie de 1.924 �
1.931 par Cecil M.Firth, l'arch�ologue anglais alors charg� des
fouilles � Saqqarah pour le Service des Antiquit�s de l'�qypte, que
dirigeait despuis 1.914 le successeur direct de Gaston Maspero, Pierre
Lacau. C'est par ce savant �gyptologue que je fus engag� pour 8 mois;
il ya a de cela plus
de 68 ans, en vue d'�tudier les tr�s nombreux �l�ments
architectoniques sortis des fouilles de Firth et assister ce dernier
dans ses recherches. Mais il y a lieu, sans plus tarder, de vous pr�senter
et commenter nos projections.
Conclusion
En r�sum�, il convient dans l'oeuvre architecturale si
remarquable d'Imhotep � Saqqara de distinguer deux sortes d'�dificies de
caract�res fort diff�rents. Les uns au r�le purement figuratif ou
symbolique sont le plus souvent pesque enti�rement massifs int�rieurement,
tandis que les autres � destination pratique ou cultuelle effective pr�sentent,
au contraire, des plans accessibles aux divers officiants. Les �difices
du premier groupe, essentiellement ceus de l'ensemble dit du
"Heb-sed" et les "maisons du Sud et du Nord", qui
traduisent dans la pierre les formes issues d'une lointaine architecture
pr�dynstique, ainsi providentiellement retrouv�e, marquent l'apog�e et
le terme de l'art Thinite, mais ne constituent pratiquement que des
simulacres: nous avons affaire l� � des maquettes r�alis�es en dur et
en vraie grandeur, formant un immense d�cor � vertu magique mis � la
disposition de ka royal pour l'au-del�. Pareille architecture, o� les �l�ments
architectoniques des fa�ades sont trait�s en simples hauts-reliefs, ne pouvait ainsi gu�re avoir de
lendemain et dut bient�t c�der la place � la figuration en bas-reliefs,
qui, tout en n�cessitant beaucoup moins de superficie, offrait des moyens
d'expression infiniment plus riches. D�s le d�but de la IV�me dynastie,
en effet, les parois des salles des temples fun�raires royaux se
convriront de bas-reliefs o� seront �voqu�es toutes les sc�nes
susceptibles d'assurer magiquement la survie royale de ka dans l'au-del�.
En revanche, les constructions du second groupe, comprenant
principalement l'enceinte � redans et son bastion d'entr�e suivi du long
hall aux colonnes fascicul�es, ainsi que la Pyramide � degr�s m�me
avec son temple de culte fun�raire accol� � sa face nord ont
manifestement constitu� le point de d�part de l'architecture en pierre
de taille. Tout en substituant cette derni�re � la brique crue ou au
bois, Imhotep sut garder � l'architecture nouvelle qu'il cr�ait, la
puret� et la remarquable �l�gance des constructions ant�rieures, qui
utilisaient ces mat�riaux plus l�gers. Les proportions donn�es par lui
tant aux divers murs � redans qu'aux trav�es de la colonnade d'entr�e
et aux portiques � colonnes cannel�es du temple fun�raire demeurent �
l'�chelle humaine et t�moignent de la plus heureuse harmonie. On y
trouve les lignes simples et pures de l'Ancien Empire, mais sans le caract�re
massif que l'architecture predra bient�t sous la IV�me dynastie. Si les
colonnes apparaissent encore syst�matiquement engag�es dans des piles
d'appui ou des mur, cela fut dans le souci l�gitime, �tant donn� le
grand fractionnement de leurs tambours, d'assurer leur stabilit� pour l'�ternit�.
De m�me, leurs bases �vas�es pour permettre une meilleure assise sur le
sol, et leurs larges abaques facilitant la prise en charge des architraves
t�moignent d�j� d'un sens av�r� des lois de la construction.
Enfin, pour l'�dification m�me de la pyramide � degr�s,
gigantesque escalier symbolique vers le s�jour des dieux, qui allait
recouvrir le mastaba initial avec son vaste puits contenant le caveau en
granit de Djoser si profond�ment enfoui, Imhotep fit l� encore oeuvre
magistrale. Il imagina pour �lever ce monument jusqu'� une soixantaine
de m�tres, hauteur consid�rable pour l'�poque, une structure en
tranches, inclin�es de 161,
de gros blocs � lits ainsi d�vers� d'autant vers le centre, agissant
comme des contreforts successifs accol�s les uns aux autres. Sa pyramide
� degr�s fit �cole, les successeurs de Djoser en construisirent �galement,
et c'est de ce type de superstructure que naquit moins d'un si�cle plus
tard, avec l'av�nement du roi Sn�frou, fondateur de la IV�me dynastie,
la pyramide v�ritable aux faces triangulaires. Ainsi, bien que le concept
de cette derni�re ne lui soit pas imputable, Imhotep peut, n�anmois, �
juste titre �tre consid�r� comme le promoteur de l'id�e de ces
constructions pyramidales, qui allaient pendant plus d'un mill�naire
marquer et abriter les s�pultures des pharaons, tout en orientant l'�volution
de l'architecture monumentale �gyptienne vers le colossal qui en
demeurera l'une des principales caract�ristiques. Jean-Philippe Lauer.
BIBLIOGRAFIA Lauer,Jean-Ph.:
Les Pyramides de Sakkara.I.F.A.O,Le Caire,1.991.
Sur l'emploi et le r�le de la couleur aux
monuments du complexe fun�raire du roi Djoser.
R.E.,tome 44, Par�s,1.993.
|